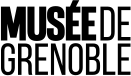Sicile

La trajectoire fulgurante de Nicolas de Staël
(1939-1955) lui a parfois valu d’être comparée à
la destinée de Van Gogh. Des sombres et hautes
pâtes de ses débuts aux ateliers évanescents
de la dernière période d’Antibes, De Staël a
identifié l’aventure de la peinture à sa vie même,
assimilant celle-ci à un approfondissement
incessant des moyens picturaux. Originaire
de Russie, formé à Bruxelles, De Staël fait son
apparition sur la scène parisienne au lendemain
de la Seconde Guerre mondiale alors que
culmine le débat opposant l’abstraction à la
figuration. Soutenu par Alberto Magnelli et par
Sonia Delaunay, qui le qualifie, au début des
années 40, de « peintre inobjectif », il réalise des
toiles abstraites aux harmonies sombres que
l’on a comparées à celles de son compatriote
André Lanskoy. Mais ne pouvant se satisfaire
de l’abstraction, l’artiste revendique une vision
intuitive, une expression libre qui trouve ses
sources dans la peinture classique, celle des
peintres nordiques qu’il admire au musée du
Louvre, mais aussi celle de Cézanne et de Braque.
« Il s’agit toujours et avant tout de faire de la
bonne peinture traditionnelle » (Lettre à Jacques
Dubourg, 1952). Qu’il s’agisse de la célèbre série
des Toits ou des paysages du Lavandou, De Staël
explore les propriétés constructives et le rôle
spatial de la couleur. L’année 1952 marque un
tournant dans sa création, un retour au motif
et à la couleur (réalisation des Footballeurs,
découverte du Lavandou et de la violence de la
lumière méditerranéenne, visite de l’exposition
Le fauvisme au Musée national d’art moderne, à
Paris).
Au cours de l’été 1953, Nicolas de Staël prend la
route de l’Italie avec sa famille. Agrigente est le
point culminant du voyage où naît une série de
tableaux, dont Sicile, marquée par le triomphe de
la construction de l’espace par la couleur. Dans ce
paysage synthétique, les couleurs posées en aplat
sont éclatantes, la plaine est comme brûlée par
le soleil aveuglant de Sicile. De grandes plages
jaunes et orangées convergent vers un point
de fuite unique. De Staël détourne là un procédé
ancien, celui de la perspective monofocale,
également adopté dans les paysages de
La Route d’Uzès, réalisés la même année. Le
ciel vert marqué par les éraflures au couteau
s’oppose au jaune citron et au bleu profond
de la mer. Le choc de la découverte de L’Atelier
rouge (1911) de Matisse à New York comme des
collages réalisés l’année précédente expliquent
« l’extrême simplification des signes » (Pierre
Gaudibert) de cette toile où la peinture, étendue
en minces couches raffinées, contraste avec celle
des œuvres antérieures, plus matiéristes. Un an
plus tard, De Staël se donnera la mort, laissant
inachevé Le Concert (musée Picasso, Antibes).
Un autre regard
-

A ciel ouvert
Petit tour d’horizon (et de ciels) dans les collections du musée !
-

-

Invitation au voyage
Le monde est une invitation, un appel au voyage ! Depuis le XVIIe siècle, les artistes en quête d’inspiration partent découvrir d’autres pays, d’autres cultures.
-

La figuration jusqu’aux années 50
L’art moderne, à l’image de son siècle, porte la marque de transformations profondes et de changements d’intentions décisifs de la part des artistes.
Découvrez également...
-

Le Cap Layet
1904 -

Paysage à l'enfant
1923 -

La Cage
1950