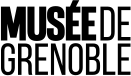Bibiana (Ne m'oubliez pas)

Les trente dernières années du XIXe siècle sont
essentiellement italiennes pour le peintre
Ernest Hébert qui ne rentrera définitivement
à Paris qu’en 1896, à plus de soixante-dix-neuf
ans. Dans cette période riche en mouvements
littéraires et artistiques, l’oeuvre d’Hébert se
ressent de l’influence du symbolisme qui se
développe alors en France et du préraphaélisme
tardif qui trouve encore une audience
forte à Rome.
Bibiana a été peint entre 1889 et 1891 tandis
qu’Hébert dirige l’Académie de France à
Rome pour la seconde fois (1885-1890). « J’ai
commencé, pendant les six ans que je viens
de passer ici, quelques tableaux dans mon
petit jardin, qu’il faut enfin terminer et que
je ne peux terminer que d’après les modèles
de ce pays[1] », écrit-il à Jean-Jacques Henner
le 19 février 1891, au moment de quitter son
poste. L’Italienne au nez busqué et au regard
de braise est, pour cette période, avec Amelia,
l’un des modèles préférés de l’artiste. Il y en
eut cependant beaucoup d’autres : Caterina,
Giovannina, Adélaïde, Elvira qui étaient
modèles pour le peintre avant de repartir
faire les moissons dans leur village. Gabrielle
Hébert, qui accompagnait son mari à Rome,
nous a laissé de nombreuses photographies
de ces paysannes lors des séances de pose.
Selon le tableau en cours, elles endossaient
soit le costume traditionnel, soit les voiles
de la Vierge, leur plus jeune enfant tenant
souvent le rôle de Jésus.
Ici, Bibiana est de profil, adossée au mur du
bassin de la terrasse de l’atelier romain d’Hébert,
dans une composition proche de celle de Rosa
Nera peinte quelques années plus tôt. La mise
en scène, resserrée sur le sujet, ainsi que le
clair-obscur mettent l’accent sur le haut du
buste et le visage. Ils confèrent au portrait une
intensité qui fait oublier l’effet anecdotique
de sa tenue des Abruzzes (blouse blanche aux
amples manches, corselet et jupe de travail
bleu indigo). Le drapé d’un châle au motif
perse, largement noué à la taille, accentue
son allure presque orientale. Le tableau est
caractéristique de la période des années
1890 où Hébert, situant ses personnages en
plein air, sur un fond de verdure, joue sur
les rapports colorés de la végétation et des
tissus. Le profil, tourné vers la gauche, et les
yeux baissés laissent paraître une certaine
mélancolie sous le fier détachement. À peine
aperçoit-on dans sa main la discrète fleur de
myosotis qui donne son sous-titre au tableau.
L’artiste puise les sources picturales de son
inspiration dans les différents courants de
cette période, qui lui permettent de renouveler
son goût pour les figures féminines. Il
réalisera ainsi à la Villa Médicis une série de
portraits allégoriques privilégiant l’expression
des états d’âme. Le modèle y est peint,
selon le sujet, en costume traditionnel ou dans un drapé plus suggestif, voire parfois nu
(La Solitaire, 1889, La Lavandara, 1890, ou
encore Fleur d’oubli, 1892). En 1891, obligé
de laisser le logement de directeur à son
successeur Eugène Guillaume, le peintre s’est
installé non loin de la Trinité des Monts, dans
un appartement de la Via Sestina. Homme
d’habitude, il conserve néanmoins son atelier
de la Villa qu’il occupe depuis le premier
directorat et dont la porte est surmontée
d’un H. Celui-ci est construit sur la vieille
muraille de Rome et, bien que petit, il bénéficie
d’un jardinet étroit où Hébert aime
installer ses modèles. Il y travaille encore
régulièrement, au grand dam du nouveau
directeur qui souhaite le voir partir définitivement.
Dès lors, bravant parfois le vent et la
pluie, le peintre se contentera de la terrasse
du campanile ou du petit bois, tout au fond
du jardin de la Villa, pour poser son chevalet :
« Le coin du Bosco où je travaille me plaît
beaucoup, j’y installerais volontiers ma tente,
si le voisinage du glaçon directeur ne m’avait
dégoûté de l’Académie^2 », précise-t-il encore à
Jean-Jacques Henner le 25 septembre 1891 (?).
Quoique très lié avec Gustave Moreau, Ernest
Hébert ne peut pas être considéré comme un
des artistes appartenant au courant symboliste
français. Il n’a pas échappé cependant
à la tentation religieuse et symboliste qui a
imprégné une partie de sa production à la fin
du siècle. Le goût qui s’affirme pour les figures
allégoriques, notamment féminines, ne pouvait
que séduire le peintre. Ses muses – musiciennes,
figures religieuses et autres femmes éthérées –
sont marquées, plus ou moins consciemment,
par un penchant pour l’idéalisation qui semble
gagner alors tout le milieu intellectuel.
[1] Péladan, Ernest Hébert, son oeuvre, son temps, d’après sa correspondance et des documents inédits, préface de Jules Claretie de l’Académie française, Paris, 1910, p. 227.
Un autre regard
-

Le langage des fleurs
Quand vous offrez un bouquet, prenez-vous garde à la signification des fleurs qui le composent ? Ou bien les choisissez-vous purement pour leur beauté, leurs coloris ?
Découvrez également...
-

Vieille femme filant
XVIIe siècle -

Sainte Cécile
XVIIe siècle -

Statuette de Vénus dite de Grenoble
Ier siècle - IIe siècle