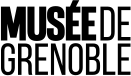Le lac Merlat et la grande Lauzière. Massif de Belledonne

Édouard Brun commence sa formation artistique
au contact de l’abbé Guétal (1841-1892),
professeur au petit séminaire du Rondeau à
Grenoble, qui l’initie à la peinture de montagne.
Il travaille également la précision de son regard
en dessinant sur le motif avec Jean Achard
(1807-1884) dans les dernières années de la
vie du patriarche. François Auguste Ravier sera
aussi une importante source d’inspiration pour
la quête des effets atmosphériques fugitifs. En
1883, il ouvre, place Saint-André, un commerce
de fournitures artistiques et cet ancrage
grenoblois lui permet d’être au coeur de la vie
culturelle locale. Quelques années plus tard, il
choisit finalement de se consacrer à la peinture
tout en conservant épisodiquement une activité
de marchand d’art. Il expose régulièrement
dans différents Salons à Grenoble, Lyon et Paris
ainsi que lors d’expositions internationales.
Comme Charles Bertier, son compagnon d’ascension,
c’est un peintre alpiniste, membre du
Club alpin français, de la Société des touristes
du Dauphiné et de la Société des peintres de
montagne. Il utilise la photographie pour
fixer le souvenir de ses courses, fait des
pochades sur le motif et note ses impressions.
Tout cela lui sert ensuite à l’exécution de ses
peintures de grand format. Il se ressource l’été
à Saint-Vincent-de-Mercuze d’où sa famille
est originaire. Ce territoire familier est le sujet
principal de beaucoup de ses aquarelles. C’est
un artiste prolifique sollicité pour illustrer des
revues (Les Alpes pittoresques notamment)
et des ouvrages consacrés à la montagne. Il
est aussi l’auteur de grands décors muraux
à Grenoble (Hôtel Moderne, chambre de
commerce, commandes privées). Il est nommé
officier d’Académie en 1900 et officier de l’Instruction
publique en 1908.
Édouard Brun affectionne la sublime âpreté des
paysages de haute montagne. Les eaux obscures
et glacées du lac Merlat, à 2 044 mètres
d’altitude, s’inscrivent dans un environnement
chaotique et aride de roches sombres qui
barrent abruptement le premier plan. Face à
cet obstacle, le regard s’échappe vers la calme
planéité de l’eau, puis se laisse conduire par une
diagonale qui ouvre une voie vers un sommet
lointain où subsistent plusieurs plaques de
neige. Un ciel serein, à peine animé de quelques
nuages, contribue à figer le site monumental
et austère où aucune trace humaine ou animale
n’est repérable. Cependant, l’artiste prend soin
d’adoucir imperceptiblement cette première
impression en plaçant, ici ou là, des buissons
fleuris au premier plan et des herbes aux tons
vifs qui rappellent que la vie revient toujours
avec l’été.
Un autre regard
-
Les paysages dauphinois
Admiré pour sa beauté, pour sa lumière et pour la diversité de ses espaces, le paysage dauphinois est un sujet cher aux artistes régionaux.
Découvrez également...
-

-

Chaouabti
XIIIe siècle av. J.-C. - XIe siècle av. J.-C. -