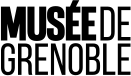Rhinocéros

Ridinger est avant tout un peintre animalier.
Exact contemporain de Jean-Baptiste Oudry,
il excelle dans les arts graphiques plus que
dans la peinture. Son oeuvre comprend mille
six cents gravures et des centaines de dessins,
acquis en partie en 1830 par le marchand
Weigel de Leipzig des héritiers de Ridinger et
publiés en 1856 par Thienemann.
Le sens de l’observation de l’artiste est aussi
juste que celui d’Oudry, ce qui a amené un
certain Jacob Brückner à composer les vers
suivants pour accompagner un autoportrait
de Ridinger gravé par son fils Martin Elias :
Wer hat das Thierreich so in seines Pinsels
Macht ? Wer gibt des Schöpfers Hand in allem
ihrem Pracht ? (« Qui tient autant le monde
des animaux dans le pouvoir de son pinceau ?
Qui donne autant de splendeur à la création
divine ? »).
Son immense créativité s’exprime aussi bien
dans les scènes de chasse, très naturelles, que
dans les scènes de genre galantes et les sujets
militaires. Ridinger a produit aussi une grande
variété de dessins animaliers, représentant
les animaux de la forêt comme les animaux
domestiques ou exotiques, et publie de véritables
recueils scientifiques sur la faune. Il
satisfait surtout les admirateurs de la nature
en dessinant et en gravant les Quatre saisons
des chiens, les Quatre moments du jour des cerfs
et d’autres curiosités de ce genre. Grenoble
possède tout un ensemble de ses oeuvres, surtout
des études d’animaux dont l’une des plus
belles est le Cerf mort (MG D 1500).
Entre le 18 mai et le 16 juin 1748, l’artiste a pu
voir un rhinocéros à Augsbourg et il l’a dessiné
à plusieurs reprises. Selon une inscription,
portée sur un dessin vendu chez Sotheby’s à
Londres, le 1er juillet 1991 (n° 30), il aurait
dessiné l’animal le 12 juin selon six angles
différents. En effet, six dessins de l’animal
ont été vendus au marchand Weigel par les
héritiers de l’artiste[1]. Outre celui de la vente,
exécuté à la pierre noire sur papier bleu qui
a servi pour une gravure, deux autres feuilles
du même motif et dans la même technique
sont connues[2]. Un autre au moins a été vendu
à Munich, le 3 et 4 novembre 1958 dans un recueil d’animaux de Ridinger[3]. Le livre
consacré à l’artiste par Mathias Goeritz, paru
en 1941, reproduit une autre étude du même
genre. Le dessin de Grenoble, exécuté à la sanguine,
est donc le dernier connu montrant cet
animal. Le rhinocéros est représenté de face,
s’appuyant contre un arbre. Il y a une petite
imprécision dans la tête comme si l’animal
avait bougé durant l’exécution du dessin.
L’animal que Ridinger a dessiné a fait fureur
en Europe[4]. Appelé Miss Clara (ou le rhinocéros
hollandais), il arrive en Hollande en 1741,
en provenance d’Inde et est la propriété d’un
capitaine en retraite, H. David Douwe Mout
van der Meer. Durant des années, il voyage
dans une cage spéciale à travers l’Europe,
d’abord dans le Saint-Empire, puis en France
– l’animal est à Paris le 3 février 1749 et Oudry
le dessine à plusieurs reprises – avant de faire
le tour de l’Italie et de l’Angleterre. Miss
Clara meurt, selon les légendes inscrites sur
certaines gravures, en avril 1758, à Londres.
T. H. Clarke, spécialiste des rhinocéros, conclut
(avec l’humour propre à son pays) : No obituary
notice has been found in London newspapers
(« Aucune notice nécrologique n’a été
trouvée dans les journaux londoniens »).
Outre la gravure citée plus haut, Ridinger
en a réalisé d’autres avec ce même motif :
une gravure colorée montrant un rhinocéros
bondissant, ou encore un combat d’éléphant
et de rhinocéros. Ce même animal est
aussi visible dans l’arrière-plan d’une gravure
d’Adam et Ève.
Peut-être l’artiste voulait-il montrer à quel
point la célèbre gravure sur bois de Dürer
datée 1515, tant répandue en Europe et
fixant l’image-type de l’animal, était fausse
et demandait à être corrigée (Dürer n’avait
jamais vu l’animal de ses propres yeux mais
l’avait dessiné d’après une esquisse envoyée de
Lisbonne).
[1] Thienemann, 1856, p. 280, no 12.
[2] Voir Clarke, 1984, p. 624-626, Clarke, 1986, p. 52-55.
[3] Le n° 1, le catalogue l’illustre à la page 8 mais la notice ne précise pas la technique.
[4] Voir Loisel, 1912, II, p. 11, 50-52, 278-280, et Clarke, 1986, p. 47-68.
Découvrez également...
-

-

Couteau esquimau, poignée
fin XIXe siècle -

L'Estaque
XXe siècle