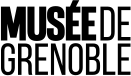Salomé demande à Hérode la tête de saint Jean-Baptiste

Le dessin était conservé sous le nom de l’artiste
allemand Heinrich Aldegrever (vers 1501-vers
1558), graveur et peintre westphalien qui jouit
au XIXe siècle d’une grande réputation. On lui
attribue à l’époque, sans véritable raison d’ailleurs,
de nombreuses oeuvres, alors qu’on le
connaît aujourd’hui principalement comme
portraitiste et ornemaniste. Un second dessin,
légué par Léonce Mesnard à Grenoble, est
entré sous une attribution à Aldegrever. Ce
Saint Jérôme est considéré aujourd’hui comme
une oeuvre, soit de Bernardino Butinone, soit
de Bernardo Zenale, et provient de la prestigieuse
collection Vallardi[1].
Cette Salomé demande à Hérode la tête de saint
Jean-Baptiste revient à Frans II Francken,
artiste flamand actif presque un siècle après
Aldegrever. Au cabinet d’art graphique de
l’Ermitage à Saint-Pétersbourg se trouve une
autre version identique, rehaussée d’aquarelle[2], et il en existe ou en existait sans
doute encore d’autres. Au premier plan se profilent
Salomé et Hérode. À l’instigation de sa
mère Hérodias, Salomé demande à Hérode la
tête de saint Jean-Baptiste. Visiblement irrité,
le roi cède à sa demande, durant un festin,
comme il l’avait promis auparavant. Dans
l’arrière-plan à gauche, sous un porche, prend
place le festin, la fête d’anniversaire d’Hérode,
alors qu’à droite, devant sa prison, se déroule
la décapitation du saint[3]. Le regard sombre
d’Hérode et son costume oriental se retrouvent
dans d’autres peintures de Francken comme
par exemple dans la figure du sinistre empereur
Dioclétien, sur le panneau central du triptyque
Les quatre saints couronnés, commandé
par la guilde des sculpteurs d’Anvers en 1624[4].
Francken est, au début du XVIIe siècle, l’un
des artistes les plus populaires d’Anvers. Un
important atelier lui permet de répondre à
de nombreuses commandes et de diffuser
son oeuvre. Les innombrables variantes et
copies sorties de cet atelier sont souvent de
très grande qualité, de sorte que la question
d’une éventuelle participation de Francken
à ces oeuvres se pose à de multiples reprises.
Ses compositions variées, animées de nombreuses
figures, son style vigoureux et narratif
lui assurent de son vivant une renommée européenne. Comme bon nombre de ses collègues,
Frans Francken II collabore parfois avec
d’autres artistes anversois. Spécialisé dans les
figures humaines, il s’associe à des paysagistes,
des peintres animaliers et de fleurs ainsi que
des peintres d’architecture pour créer une
oeuvre en commun.
Ses nombreux tableaux religieux et profanes
sont finement peints, très détaillés et l’aspect
pittoresque y domine. Francken invite le spectateur
à se délecter des habits somptueux, des
accessoires précieux et des intérieurs tantôt
grandioses, tantôt intimes. L’artiste préfère un
point de vue assez aérien qui lui permet d’embrasser
une multitude de choses représentées.
La feuille de Grenoble montre que les dessins
finis, rehaussés d’aquarelle, étaient aussi très
recherchés des amateurs même si le nombre
de ceux qui sont conservés est plus limité
aujourd’hui en raison de leur fragilité. Exécutée
à la même période que ses tableaux, cette
oeuvre est marquée par un retour délibéré à la
Renaissance, période à laquelle brillait Anvers
de sorte que l’attribution à Aldegrever, peintre
du début du XVIe siècle, n’est pas dénuée de sens.
Pourtant, cette feuille de Francken, conservée
jusqu’alors sous le titre Couple en tenue de
cour, s’inspire plutôt de dessins de Bernard van
Orley. La nostalgie de cette période, faste mais
de courte durée et interrompue par les conflits
religieux, est bien sensible dans l’art anversois
du XVIIe siècle.
Francken dessinateur demeure un sujet peu
travaillé. On connaît surtout de sa main des
dessins préparatoires à ses peintures. Citons
le Triomphe d’Amphitrite du Kupferstichkabinett
à Dresde[5], qui prépare le tableau de
même sujet conservé à Manchester (New
Hampshire), Currier Gallery of Art[6], et dont
l’exécution est plus cursive et rapide que la
feuille de Grenoble.
[1] MG D 2 ; voir cat. exp. Grenoble, 2010, cat. 2, p. 28-33, repr. p. 29. Pour Valardi, voir aussi cat. 2.
[2] Musée de l’Ermitage, Inv. 3109 ; voir cat. exp. Bruxelles, Rotterdam, Paris, 1972-1973, n°36, repr.
[3] Voir Matthieu, XIV, 3-12 et Marc, VI, 17-29.
[4] Anvers, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, Inv. n°158-162 ; voir Härting, 1989, n°258, repr.
[5] Härting, op. cit., p. 97, ill. 89.
[6] Härting, op. cit., p. 96, ill. 88.
Découvrez également...
-

Encrier carré, avec godet différent
1ère moitié XVIIIe siècle -

-

Portrait d'Emile Léon d'Apvril
XIXe siècle