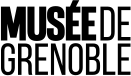Masque plastron de femme

Plâtre peint
29 x 56 cm
MG 1284
Don de Léon de Beylié en 1900
MG 1284
Plâtre peint
23 x 18 cm
MG 1285
Don de Léon de Beylié en 1900
MG 1285
Les masques funéraires proviennent vraisemblablement
des fouilles du Français Albert Gayet (1856-1916) dans les
nécropoles d’Antinoé (Antinoopolis), sur la rive droite du
Nil en Moyenne-Égypte. La grande métropole égyptienne
est une fondation d’époque romaine, sous le règne de
l’empereur Hadrien (117-138), baptisée en l’honneur de
son favori Antinoüs après son décès accidentel en 130 de
notre ère. Ces deux pièces auraient été exhumées au cours
des premières campagnes de l’archéologue sur le site (soit
entre 1896 et 1899), subventionnées tour à tour par une
brève société privée patronnée par l’orientaliste Émile
Guimet (1836-1918), la chambre de commerce de Lyon et la
Société française du Palais du costume (société anonyme
composée d’actionnaires).
Quoique leur provenance ne soit pas entièrement éclaircie,
les circonstances de leur acquisition sont maintenant
connues, grâce à des pièces d’archives. Ils ont été acquis
simultanément à Paris par le colonel de Beylié auprès de
l’antiquaire Paul Philip (actif entre 1892 et 1905), lors de
l’Exposition universelle de l’été 1900, contre les sommes
respectives de 300 et 200 francs selon le reçu conservé et
daté du 7 août 1900. Léon de Beylié mentionne d’ailleurs
immédiatement son achat dans une première lettre
adressée le jour même ou le lendemain au conservateur
du musée de Grenoble, Jules Bernard (1849-1917), puis
dans une seconde, du 9 août 1900. Toujours dans une note
adressée au conservateur, L. de Beylié donne l’origine de
ses acquisitions, probablement d’après les indications
communiquées oralement par le vendeur. Ce dernier,
P. Philip, était un marchand d’art installé au Caire, « fournisseur
des musées d’Europe en antiquités égyptiennes et gréco-romaines
» et dont la propre collection sera elle-même
dispersée en vente publique à l’Hôtel Drouot quelques
années plus tard, les 10, 11 et 12 avril 1905.
Le don au musée de Grenoble est effectué très tôt, dès
le 10 août 1900, selon la mention portée sur l’inventaire où les
masques sont dès lors enregistrés. Les auteurs du catalogue
de la collection égyptienne de Grenoble, publié en 1979,
ne les avaient pas alors repérés dans l’inventaire existant ;
c’est la raison pour laquelle ils figurent sous de nouveaux
numéros d’inventaire (respectivement MG 3627 et MG 3628),
tout en étant notés de manière erronée comme « don de
la Société française de fouilles archéologiques, 1907 ».
D’autres sites égyptiens ont livré des pièces semblables,
à une époque à peu près contemporaine de celle des
fouilles d’Antinoé (1895-1914) d’où sont effectivement issus
de nombreux spécimens : Balansourah et Touna al-Gebel
situés dans la même région de Moyenne-Égypte, mais sur la
rive opposée, ainsi que l’oasis de Kharga. Touna al-Gebel
semble avoir été le grand centre de fabrication des
masques plastrons en plâtre.
Exceptionnellement conservés et de belle facture, nos
deux masques témoignent des pratiques funéraires alors
en usage, mélange de religion égyptienne et de culture
gréco-romaine. Simplement posés sur le corps, ils étaient
maintenus en place par des bandelettes et constituent une
vision abrégée du cercueil, leur plastique reproduisant les
traits idéalisés du défunt. Ils entrent dans une typologie
attribuée au IIIe siècle, caractérisée par l’angle droit formé
par la tête et le buste, la tête fortement levée manifestant
l’éveil du défunt en Osiris. À partir d’une matière première
commune, le gypse, ils ont été moulés en plusieurs parties, la
chevelure étant réalisée à part puis plaquée sur le crâne, ainsi
que les ornements. La polychromie est ensuite appliquée,
permettant d’individualiser le masque qui pouvait être
fabriqué en série. Enchâssé, l’œil est ici formé par une pâte
noire et blanche, sorte d’émail à l’aspect vitreux donnant
vie au regard.
Le premier masque, le mieux conservé, est à peu près
intact et garde encore une étonnante polychromie,
notamment pour le manteau et les chairs, d’une couleur
rosée ; les yeux sont incrustés. Il permet, par de nombreux
détails, de se faire une idée du luxe du costume de la
défunte : elle est revêtue d’une tunique bleu clair à bandes
verticales descendant sur la poitrine (les clavi) de couleur
sombre ; le manteau jeté sur les épaules apparaît d’une
teinte soutenue, bleu-vert sombre. La femme porte en
outre de nombreuses parures en relief et peintes : des
boucles d’oreilles (dorées à l’origine), un collier à double rang
en sautoir (perles vertes sur tige d’or), un bracelet torsadé au
poignet droit (celui du poignet gauche s’est arraché) et
trois bagues (simple anneau à l’annulaire de la main droite
et bagues à chatons à la gauche). La masse des cheveux,
partagée sur le devant par une raie médiane, est coiffée en
bandeaux ondulés sur huit rangs et se termine sur la
nuque par un large chignon enroulé.
Sous la poitrine, sa main gauche est posée à plat tandis
que la droite enserre la guirlande de fleurs formant une large
boucle entre les seins menus ; elle évoque le signe ânkh,
croix de vie qui est l’attribut du justifié d’Osiris, c’est-à-dire
du défunt qui s’apprête à renaître dans l’au-delà selon
l’antique tradition égyptienne.
Le second masque, incomplet, est d’un aspect très
sobre quoique raffiné ; il conserve encore, notamment sur
les boucles d’oreilles à deux perles, quelques traces de
dorure, qui était appliquée à la feuille d’or. Les yeux sont
incrustés et sertis comme pour le précédent, mais cette fois
le fond du portrait est blanc avec les cheveux et sourcils
peints en noir. La femme porte sa chevelure, divisée à l’avant
en deux bandeaux tressés qui couvrent le haut du front et
des oreilles, et enroulée à l’arrière en un chignon très plat.
Par chance, nous connaissons l’identité de la jeune
femme, grâce à une inscription figurant à l’arrière de la
tête, sur l’encolure du manteau encore présent. Il s’agit
d’une élégante inscription hiéroglyphique, elle aussi
peinte en noir, que nous restitue une seule ligne constituant
le début d’un petit texte : « Paroles prononcées par l’Osiris
Tanekhatis, justifiée […] », selon un formulaire conforme
aux croyances encore païennes. À l’époque romaine, toute
l’efficacité magique du rituel funéraire se concentre sur la
préservation du nom, composante essentielle et vivante
de l’individu : être oublié signifie sombrer à jamais dans le
néant. Aussi le nom est-il soigneusement écrit et répété
sur le matériel accompagnant le défunt : bandelettes,
étiquette de momie, portrait peint, stèle, etc.
Découvrez également...
-

Coffret à oushebtis de Ramosé et Tapakhenti
XVIe siècle av. J.-C. - XIIIe siècle av. J.-C. -

Pectoral du marin Pentaour
XIIIe siècle av. J.-C. - XIe siècle av. J.-C. -

Simulacre de vase décoré, inscrit au nom de Neferhebef
XVIe siècle av. J.-C. - XIIIe siècle av. J.-C.