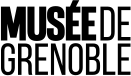(Sans titre)

La présence des armes de la famille Piccolomini
à main gauche, tenues par deux putti, a
facilité l’identification du sujet représenté, à
quelques nuances près, car deux papes Piccolomini
ont été élus et couronnés : Pie II, le plus
célèbre, et Pie III, son neveu. Si le pontificat du
premier fut relativement long et mémorable
(1458-1464), le second fut en revanche fort
bref puisque élu le 22 septembre 1503, il
mourut le 18 octobre 1503. L’origine siennoise
des deux papes permettait en tout cas d’envisager
une hypothèse d’ancrage géographique
du dessin à Sienne, même si nous avons un
temps hésité, car une telle scène aurait pu être
peinte à Rome par un artiste romain ou établi
à Rome – nous avions ainsi noté quelques
points de convergence avec la manière d’un
Giovanni Baglione. La découverte, dans un
ouvrage consacré au Palazzo Pubblico de
Sienne, d’une reproduction d’une peinture
murale à l’huile reprenant l’ordonnance
générale étudiée sur le dessin avec quelques
variantes, a mis un terme à ces errements
géographiques, sans pour autant résoudre de
manière définitive la question de son attribution,
tant du dessin que de la peinture.
Cette peinture occupe la voussure d’une voûte
en berceau, dans la deuxième salle dite Sala di
Biccherna au rez-de-chaussée du Palazzo
Pubblico, et représente le Couronnement de Pie
II, lequel eut lieu le 3 septembre 1458. Au
sommet de la voûte, se trouve une autre
peinture murale à l’huile montrant L’archevêque
de Mayence faisant connaître aux représentants
de Sienne les privilèges fiscaux consentis
par l’empereur Frédéric à la ville ; elle est attribuée
à Astolfo Petrazzi. Sur l’autre voussure, est
peint un sujet en pendant du premier représentant
Pie II Piccolomini donnant Radicofani à
Sienne, vraisemblablement de la même main
que la composition qui lui fait face. Celle-ci est
organisée selon un schéma ternaire. Au centre,
le couronnement proprement dit du nouveau
pape, et tout autour en arc de cercle, en partie
occultés par le drapé du dais, les hauts dignitaires
de l’Église assistant à la cérémonie. Deux
éléments para-iconiques, pourrait-on dire, sont
figurés au premier plan. Ils donnent des renseignements
sur le sujet représenté et sur le
commanditaire de l’œuvre. Le premier est
figuré à main gauche et montre deux putti
tenant un cartel fixé à une plaque sur lequel est
précisée en latin l’identité du pape intronisé. À
main droite est représentée une figure
d’homme vue en buste tenant un écu, sur lequel
sont peintes les armes de la famille Piccolomini
d’Aragona. Il est montré à l’intersection de
l’espace de l’historia et de l’espace réel vers
lequel son buste est dirigé. Cette figure fait en
fait office de figure de liaison entre le sujet peint
et le spectateur. Son rôle est de montrer les
armes du commanditaire dont le nom apparaît
sur l’écu : Francesco Girolamo Piccolomini, de
la famille des Piccolomini d’Aragona. Les traits
individués de cette figure font dire qu’il s’agit
vraisemblablement de son portrait. Francesco
Piccolomini fut questeur de la Biccherna : c’était
un magistrat chargé des finances de la ville de
l’année 1631 à 1633. C’est sûrement durant son
mandat qu’il commanda ces deux peintures. Le
dessin de Grenoble présente quelques variantes
de disposition mineures par rapport à la peinture. Elles concernent principalement les
figures para-iconiques qui se réduisent sur la
feuille à la présence de deux putti tenant les
armes Piccolomini. L’adjonction de la figure de
bord de droite, exigée très certainement par le
commanditaire, a du coup contraint le peintre
à modifier la disposition du groupe de figures,
montrant un ecclésiastique tenant la mitre du
pape élu, accompagné d’une autre figure
portant un plat. Sur la peinture, ce dernier
personnage est supprimé.
Le nom du peintre n’est en revanche pas inscrit
et s’est du coup perdu. Trois noms ont été
avancés. E. Romagnoli, peu avant 1835, pensait
que les deux peintures pouvaient être attribuées
à Astolfo Petrazzi (1580-1653). Celui-ci ayant
peint le tableau central, il était d’une certaine
manière logique d’étendre cette attribution aux
deux autres tableaux latéraux. Cette proposition
n’est plus retenue par les connaisseurs
actuels de la peinture siennoise du Seicento. En
1983, Gabriele Borghini a ainsi proposé de les
attribuer à Bernardino Mei (1612-1676), certainement
le plus grand peintre siennois de cette
époque, synthétisant à la fois les manières de
ses devanciers et celle moderne, issue de
courants « naturalistes ». Cet avis a été rejeté
par Marco Ciampolini qui y voit une œuvre
typique de Raffaello Vanni, un Vanni sensible
toutefois dans son faire à la manière de Petrazzi,
ce qui semble aller de soi étant donné que ces
deux peintures étaient appelées à être placées
de part et d’autre d’une œuvre de sa main. Cette
divergence de jugement tient lieu d’une certaine
manière de manifeste en matière de lecture
stylistique. On sait que Bernardino Mei fut
durant les années 1640 sensible à la manière de
Raffaello Vanni, l’un des rares Siennois à avoir
œuvré en dehors de sa ville natale et étudié sous
la direction de peintres exogènes à Sienne, après
avoir été formé par son père Francesco, l’un des
plus grands peintres siennois de la seconde
moitié du XVIe siècle – il serait ensuite passé,
selon son contemporain Ugurgieri Azzolini,
dans l’atelier de Guido Reni à Rome, puis dans
celui d’Antonio Carracci toujours à Rome. C’est
cette composante vannesque que l’on peut lire
sur cette peinture. Mais pour G. Borghini, cette
composante est à lire comme une influence,
tandis que pour M. Ciampolini, elle définit le
caractère même de l’œuvre si bien qu’il est
possible de dire, à ses yeux, qu’elle revient à
l’initiateur de cette manière. On ajoutera à cette
analyse purement stylistique une note historique,
laquelle va dans le sens de l’avis émis par
M. Ciampolini. En 1631, Raffaello Vanni est à
Sienne. Il aurait donc pu peindre les deux
peintures de la voussure de la Sala di Biccherna.
À cette date, Mei est bien trop jeune. En fait, on
connaît extrêmement peu de peintures de sa
main datant des années 1630. Et celles qu’il
réalise par la suite sont conçues dans une veine
stylistique totalement différente.
L’analyse stylistique du dessin pourrait-elle
aider à l’attribution de la peinture ? Si depuis
les recherches de Philip Pouncey, on connaît
maintenant assez bien la manière graphique
d’Astolfo Petrazzi, celles de Bernardino Mei et
de Raffaello Vanni sont en revanche moins
connues. Force est de reconnaître que si les
noms de Mei et de Vanni n’avaient pas été
avancés, celui de Petrazzi aurait pu convenir au
regard de l’existence de dessins présentant un
faire comparable, notamment un dessin récemment
acquis par le British Museum[1] étudiant
une Présentation au Temple : les figures sont
entièrement construites au lavis de sanguine ;
et tant d’un point de vue technique que stylistique,
les ressemblances sont troublantes avec
le dessin de Grenoble. C’est peut-être en considérant
le sujet étudié au verso à la plume et à
l’encre brune – de la même main que celui
étudié au recto, cela semble incontestable –,
lequel ne présente guère d’affinités avec la
manière de Petrazzi, que le nom de Vanni peut
être avancé. On retrouve sur quelques feuilles,
publiées sous son nom, des stylèmes comparables.
C’est à l’heure actuelle, en tout cas, le
nom qui convient le mieux tant pour la
peinture que pour le dessin.
[1] Inv. 2001,0519.24. Voir la notice d’Hugo Chapman sur le site Internet du British Museum et la reproduction qui l’accompagne.
Découvrez également...
-

Nature morte aux poissons
XIXe siècle -

Anneau
IIe siècle - IIIe siècle -

Espoir
1944