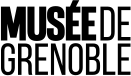Arbres au bord d'une rivière
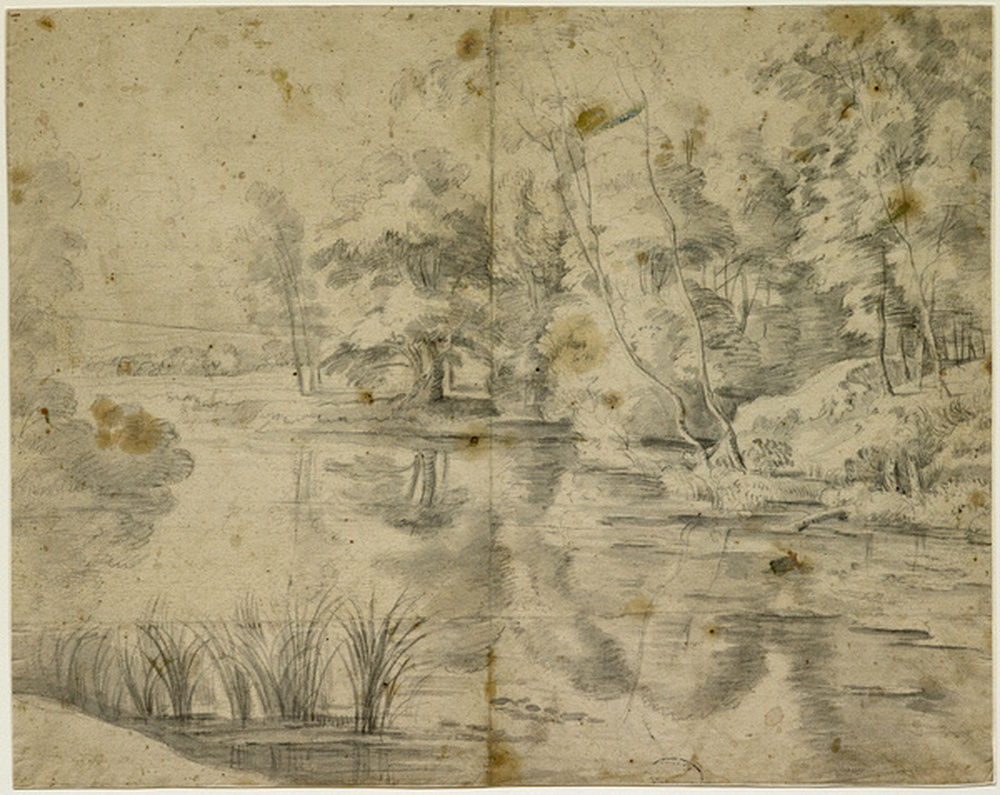
Cette belle feuille, dont le charme n’est pas
entamé par les taches d’atelier qui parsèment
sa surface, est entrée dans la collection sous
le nom de Lucas van Uden. L’attribution a
ensuite, à juste titre, été rejetée, et le dessin était
jusqu’à aujourd’hui classé parmi les anonymes
flamands[1]. L’exécution graphique comme
le sujet représenté rapprochent l’oeuvre des
études produites par Lodewijk de Vadder.
Peintre de paysages, aquafortiste et créateur de
cartons pour la tapisserie, cet artiste est considéré
comme le fondateur et l’une des figures
de proue de l’école de Bruxelles[2]. Il est d’ailleurs
désigné par son contemporain le tapissier
Baudouin van Beveren comme « le meilleur
paysagiste » du pays[3]. On ne sait rien de
sa formation mais De Vadder devient maître
auprès de la guilde de Saint-Luc de Bruxelles
en 1628 et « peintre privilégié » des cartons de
tapisserie bruxellois[4] en 1644.
Les paysages créés par Lodewijk de Vadder
s’inspirent des sites des environs de Bruxelles
et notamment de ceux de la forêt de Soignes,
au sud-est de la ville[5]. Il y fait des études
d’après nature qu’il complète parfois en atelier
comme c’est probablement le cas d’une de ses
feuilles conservées à Hambourg (Hamburger Kunsthalle, Kupferstichkabinett, Inv. n°22604)[6].
Ses oeuvres se caractérisent par un traitement
spontané, enlevé et un rendu que l’on pourrait
qualifier d’atmosphérique. Aux touches
libres de ses tableaux répondent les longues
hachures hâtives de ses esquisses dessinées. La page que Cornelis de Bie consacre à l’artiste
contient un éloge de son travail qui semble
avoir été rédigé pour décrire la feuille grenobloise
: « [lorsque la nature était à l’apogée de
sa beauté,] on voyait alors l’esprit de De Vadder
moissonner les fruits de l’été ; il allait en
forêt au plus près des arbres pour approcher
la liberté et la souplesse de leur nature […
il dépeignait] les ruisseaux couverts ici et là
d’herbes et d’iris des marais, les étangs dans
lesquels on voit se refléter les arbres[7] ». Les
plans d’eau, où se mire la végétation sylvestre,
sont en effet des sujets que l’artiste aime à
représenter et l’on découvre notamment des
échos de la composition de notre dessin dans
l’une de ses eaux-fortes[8].
On retrouve dans la feuille de Grenoble
d’autres motifs qui caractérisent les études
de De Vadder. Si les deux dessins de Turin et
celui de la Collection Frits Lugt sont réalisés
dans une technique différente – à la pointe du
pinceau et non pas à la pierre noire comme ici
–, ils présentent tous trois ces mêmes troncs
d’arbres fins et penchés et, pour Turin, ces
iris qu’affectionne De Vadder, selon les dires
de Cornelis de Bie[9]. Plusieurs dessins, dans
lesquels De Vadder utilise cette fois essentiellement
une technique sèche, sont proches
de la facture de l’oeuvre grenobloise. Dans
une feuille conservée à Francfort, exécutée à
la pierre noire et rehaussée de lavis, la cime
arrondie des arbres est traitée de façon fort
similaire[10]. On retrouve cette même caractéristique
dans un dessin conservé à Édimbourg,
accompagnée des hachures parallèles que l’on
voit généralement dans les feuilles de l’artiste[11].
Celles-ci dominent le paysage conservé
à Hambourg qui présente bien des
similitudes avec le dessin de Grenoble[12].
L’oeuvre dessiné de De Vadder n’a pas encore
reçu suffisamment d’attention pour être bien
défini et surtout clairement distingué des
feuilles de Jacques d’Artois (1623-1686) et
de Lucas Achtschellinck (1628-1699) qui fut
probablement son élève[13]. D’Artois, devenu
maître peintre en 1644, prend la tête des paysagistes
bruxellois après le décès de De Vadder[14].
Ses dessins sont toutefois plus décoratifs
et lorsqu’il utilise la pierre noire, ses hachures
sont plus courtes et moins nerveuses que celles
traditionnellement associées avec l’oeuvre de
De Vadder[15].
[1] Les dessins du peintre anversois Lucas van Uden (1595- 1672) ne présentent pas le caractère très enlevé, esquissé, que l’on trouve ici. Toutefois, De Vadder a probablement connu personnellement son confrère ; voir Van Sprang, 2000, p. 186.
[2] Ibid., et Klaus Ertz dans Essen, Vienne, 2003-2004, p. 364.
[3] Le tapissier lui a d’ailleurs versé la somme colossale de 1 000 florins pour la réalisation d’un carton pour Diane et Pan. Voir notamment Klaus Ertz dans Essen, Vienne, 2003-2004, p. 367, note 11 et Y. Thiery, M. Kervyn de Meerendré, 1987, p. 113.
[4] Il ne s’agit pas d’un titre à proprement parler : le magistrat de Bruxelles accorde à De Vadder certains privilèges en lien avec ses activités de cartonnier au service des liciers de la ville ; voir Van Sprang, 2000, p. 187-188.
[5] Pour la forêt de Soignes comme source d’inspiration des paysagistes bruxellois, voir Van Sprang, 2000, passim et pour De Vadder, ibid., p. 186-187.
[6] Stefes, 2011, n°1050, II, p. 553.
[7] De Bie, 1661, p. 98 : « Dan sachmen VADDERS gheest maeyen des Somers vrucht,/ Dan ginck hy naer het wout in’t dichtste van de boomen/ Om hunnen lossen aert in’t leven by te comen […] De beecxkens hier en daer met cruyt en lis bewassen/ Daermen de boomen oock siet schijnen inde plassen. »
[8] Hollstein, 1949-2010, XXXI, n°10.
[9] Sciolla, 2007, n°30, p. 40 ; Teréz Gerszi dans Turin, 1990, n° 143 ; Londres, Paris, Berne, Bruxelles, 1972, n°113, pl. 98.
[10] Graphische Sammlung im Städelschen Kunstinstitut, Francfort-sur-le-Main, Inv. 2810 (voir site du RKD, ill. n°0000195072).
[11] National Gallery of Scotland, Inv. n°RSA 86 ; voir Andrews, 1985, I, p. 89 et II, fig. 592.
[12] Fusain, lavis gris et brun, 18,4 x 27,5 cm, Hambourg, Hamburger Kunsthalle, Kupferstichkabinett, Inv. n°22604.
[13] C’est ce qu’affirme Cornelis de Bie (1661, p. 399) et que Sabine van Sprang considère comme plausible (Van Sprang, p. 191, note 48).
[14] Van Sprang, 2000, p. 187-188 et Klaus Ertz dans Essen, Vienne, 2003-2004, p. 364.
[15] Voir ainsi la feuille de Hambourg, Inv. 21635, Stefes, 2011, n°13, ill.
Découvrez également...
-

-

Bloc conservant le fragment d'une scène rituelle (amas d'offrandes)
XVIe siècle av. J.-C. - XIIIe siècle av. J.-C. -

Saint Paul à Athènes
XIXe siècle