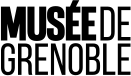Capucin

Théodore Caruelle d’Aligny suit un premier enseignement dans l’atelier de Jean-Baptiste Regnault mais la personnalité de ce premier maître le marque peu et c’est auprès de Louis-Etienne Watelet, paysagiste, qu’il trouve sa vocation. Là, il apprend à regarder la nature, à en maîtriser les contours par le dessin et en agencer les différentes composantes pour donner vie à un paysage. « M. Aligny, et c’est une raison d’insuccès en ce temps de réalisme, a cherché le style et l’idéal dans le paysage, élaguant le détail pour arriver à la beauté[1] ». C’est ainsi que Théophile Gautier loue le talent de Théodore Caruelle d’Aligny dans au Salon de 1861. Un premier voyage en Italie, de 1822 à 1827, le conduit à Rome puis à Naples. Il fait la connaissance de Camille Corot en 1825 et c’est ensemble qu’ils parcourent la campagne romaine à la recherche du motif. De ce séjour, Aligny rapporte un nombre considérable d’études dessinées, essentiellement des paysages des environs de Rome, au trait net et précis de crayon graphite. Un second voyage en Italie, en 1834 et 1835, le ramène dans les environs de Rome puis dans le sud, à Amalfi, Sorrente et Capri. C’est probablement dans la Ville Éternelle ou dans ses environs que Caruelle d’Aligny brosse à la plume et à l’encre brune, délicatement rehaussée de lavis, cette figure de capucin. Le modèle ventripotent, coiffé du bonnet et vêtu de la robe de bure des frères mendiants, se retrouve identique dans une autre feuille de l’artiste conservée au Louvre. Le moine est, à l’égal des pifferari (musiciens ambulant),_ lazzaroni_ et autres_ mazzochi (brigands), ou encore des paysannes en costume traditionnel (voir _Femme italienne jouant du tambourin _ ; _Italienne en costume typique _ et _Paysanne italienne _), une figure incontournable du folklore italien que les artistes se plaisent à mettre en scène dans leurs tableaux. Ainsi, Alexandre Cabanel portraiture un capucin en 1848 sous le titre _Un penseur, jeune moine _[2]. Jean-Victor Schnetz campe un _Capucin médecin en 1863[3]. Hébert lui-même n’hésite pas à poser en habit de moine capucin pour son ami Dominique Papety[4]. « Franchissez le portail du monastère des Camaldules ou de l’abbaye du Mont-Cassin, le torrent du temps s’immobilise… Vous rencontrez une autre espèce d’êtres, en eux-mêmes inaltérables bien que placés parmi les mortels[5] […]» note déjà en 1814 J. C. Eustace dans son Grand Tour d’Italie, pour souligner la dimension spirituelle et intemporelle de ces figures qui, plus que dans une France marquée par la Révolution, sont encore très présentes dans la société italienne. Caruelle d’Aligny, outre ces deux études à l’encre brune, consacre un autre dessin à deux capucins dans la campagne romaine. Ce dessin, intitulé Deux moines dans un jardin derrière Saint Pierre de Rome, a été vendu chez Sotheby’s en 1999[6]. Étrangement, la feuille est datée de 1841, date à laquelle l’artiste étudie dans la forêt de Fontainebleau. Il n’est pas possible de mettre le dessin de Grenoble ou celui du Louvre en relation avec une peinture. Et si ce dernier figure dans le catalogue raisonné de l’œuvre de Caruelle d’Aligny établi en 1988 par Marie-Madeleine Aubrun[7], le capucin de Grenoble est totalement inédit.
[1] Théophile Gautier, Abécédaire du Salon de 1861, Paris, 1861, p. 18.
[2] Alexandre Cabanel, titre Un penseur, jeune moine, 1848, Montpellier, musée Fabre.
[3] Jean-Victor Schnetz, Le Capucin médecin, 1863, Flers, musée du château.
[4] Dominique Papety,_ Portrait d’Hébert en moine capucin_, La Tronche, musée Hébert.
[5] J. C. Eustace, A Classical Tour Through Italy, Londres, 1814, 2. vol. t. I, p.219.
[6] Théodore Caruelle d’Aligny, Two Monks in a Garden behind St Peter’s Rome, plume et encre brune, 1841, vente Sotheby’s, Londres, 34/35 New Bond Street, Old Master Drawings, 7 juillet 1999, lot 190.
[7] Marie-Madeleine Aubrun, Théodore Caruelle d’Aligny (1798-1871), Catalogue raisonné de l’œuvre peint, dessiné, gravé, Paris, 1988, D.649, p. 397.
Découvrez également...
-

Poule
vers 1940 -

Masque de Diane
s.d. -

Jean-Antoine Morand
XVIIIe siècle