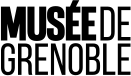Une place à Cadix

Après la réception officielle accordée par Moulay Abd er-Rahman à la délégation diplomatique française à Meknès (voir la notice de l’œuvre _Visages et silhouettes marocains _) et le retour vers Tanger, Delacroix s’offre une escapade en Andalousie en compagnie du comte de Mornay et d’Antoine Jérôme Desgranges, intégré à l’expédition marocaine en qualité d’interprète. Tous trois embarquent le 10 mai pour une courte traversée vers l’Espagne mais une mise en quarantaine de sept jours retarde leur débarquement dans le port de Cadix qui a lieu le 17 mai. Leur périple en terre espagnole dure une douzaine de jours pendant lesquels ils découvrent Cadix et Séville, visitant couvents et cathédrales. Si l’on en croit le catalogue de la vente après décès de Delacroix de 1864, dans lequel cette belle aquarelle figure sous le n° 584, celle-ci représente « Une rue à Séville » et a donc été réalisée pendant cette courte période. Achetée par le peintre Alfred Bellet du Poisat, originaire de Bourgoin-Jallieu dans l’Isère, cette feuille est ensuite léguée au musée en 1883 et devient une « place à Séville ». Si l’architecture de cette vue urbaine est clairement andalouse, elle ne ressemble à aucun site sévillan. En revanche, cette place correspond parfaitement à la place San-Francisco à Cadix avec, à droite, le couvent des franciscains, identifiable à sa porte ornée de motifs baroques. On reconnaît en effet la perspective particulière de cette place, séparée en deux espaces : une première partie triangulaire dans laquelle s’est placé Delacroix pour embrasser le site et, après le rétrécissement formé par l’angle du couvent et le bord de l’immeuble qui nous fait face, une aire rectangulaire dont on devine seulement la forme au second plan. Les crénelages et les clochetons qui surmontent les édifices de la place, et en particulier le bel immeuble de deux étages orné d’un balcon qui ferme la perspective au premier plan, ont à peine changé aujourd’hui. Dans le carnet dit de Meknès, Delacroix nous confirme sa présence dans ce lieu. Il écrit, à la date du 18 mai : « Minuit sonne aux Franciscains. Singulière émotion d’un pays si étrange. Ce clair de lune, ces tours blanches aux rayons de la lune [1]. » Il semble que l’artiste loge tout près car il décrit ensuite l’ameublement de sa chambre. Pour Michèle Hannoosh, Delacroix a dû descendre à l’Auberge française, située à proximité [2]. Ce n’est peut-être pas un hasard si la délégation française loge tout près du couvent franciscain qui abrite la chapelle Saint-Louis, sépulture des Français à Cadix depuis des siècles. Le consulat français à Cadix était encore au XVIIIe siècle installé sur cette place [3]. Dans cette aquarelle aboutie, Delacroix s’attache avec précision à la description des édifices, même s’il est obligé de modifier légèrement la vue perspective du couvent dont il rétrécit les volumes pour embrasser dans son champ de vision la porte d’entrée avec son décor de colonnes et de volutes. Il a su merveilleusement capter dans cette vue urbaine « les maisons de Cadiz blanches et dorées sur un beau ciel bleu [4] » qui le frappent à son arrivée dans le port andalou. L’insolation du papier, due à une très longue exposition à la lumière, a fait disparaître le contraste voulu par l’artiste entre les façades claires, soulignées de quelques traits de brun sur les éléments architecturaux remarquables (balcons, colonnes et fenêtres), le dallage sombre de la place et le ciel bleu violet.
[1] Louvre, département des Arts graphiques, RF 1712 bis, 66.
[2] Hannoosh, 2009, vol. 1, p. 239, note 276.
[3] Voir Anne Mézin, « La Correspondance des consuls de France à Cadix » in_ Le Consulat de France à Cadix_, publication des Archives nationales, http://books.openedition.org./pan/464, p. 10 et 11.
[4] RF 1712 bis, 64.
Découvrez également...
-

-

-

Théière
1ère moitié XVIIIe siècle